A qui de droit
Avis sur le projet d’aménagement du Lac de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie.
– expertise intuitu personae n’engageant que son auteur –
Contexte. Ayant été sollicité dernièrement par l’association LABON (Les Amis de Bagnoles-de-l’Orne- Normandie) au sujet d’un projet d’aménagement du Lac de Bagnoles en lien avec son envasement, voici quelques remarques et interrogations formulées au sujet de ce projet, projet dénommé ci-après « Le Projet ».
Préambule historique.
Le lac de Bagnoles est une formation naturelle très ancienne [Pléistocène ou début Holocène] liée à l’existence d’une cluse un peu en amont du Roc au Chien. Le Lac n’est qu’un élargissement local de la rivière La Vée et fait donc partie intégrante de cette rivière. L’Homme a utilisé cet endroit sans doute très précocement en raison :
1) de l’existence du Lac lui même (préhistoire : pêche?),
2) d’un dénivelé sur une courte distance permettant d’utiliser l’énergie hydraulique et qui a permis a) la construction d’une digue agrandissant Le Lac (réserve d’eau) et b) l’installation d’une forge conséquente. La forge et les bâtiments annexes ont été détruits le 29 juin 1811 par une crue subite de la Vée liée à un gros orage d’été.
3) de la présence d’une source chaude liée à la présence une faille dans les grès armoricains, source qui a permis le développement d’un thermalisme local conséquent dès le XIXe siècle.
Le Projet.
Le Lac se trouvant envasé actuellement au point que les pédalos s’échouent en son centre, les autorités gestionnaires locales ont préparé un projet d’aménagement pour améliorer la situation. Le Projet comprend principalement la mise à sec du lac pendant plus d’un an, puis la construction d’une digue isolant complètement Le Lac. Ce dernier deviendrait donc un étang. Le cours de La Vée se trouverait ainsi canalisée artificiellement. La digue serait aménagée en promenade pour conserver l’aspect « carte- postale » du lieu cher à la ville et à ses habitants. L’amélioration de la continuité écologique est abusivement mise en avant dans le cadre de ce projet comme nous l’expliquons un peu plus loin.
Désenvasement.
Le Projet ne comporte pas d’analyse précise des causes de l’envasement actuel. Les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, il est évident qu’il y aura envasement après un éventuel désenvasement si les causes ne sont pas connues et minimisées. Parmi les hypothèses possibles de cet envasement citons :
– La déficience au niveau de l’entretien des dispositifs existants de désenvasement naturel.
– La gestion ou non gestion de l’espace lacustre
– L’augmentation des apports de sédiments et d’alluvions en lien avec le changement certaines pratiques agricoles (labourage dans le sens de la pente, éradication des haies…).
Pour le désenvasement , le Projet ne comporte qu’une seule option, celle d’un désenvasement par curage mécanisé et donc déplacement de l’ensemble vase + alluvions + sédiments. Notons au passage que le curage à l’aide d’une pelleteuse est très onéreux et polluant. La profondeur du creusement n’est pas claire.
D’autres systèmes de désenvasement ont-il été envisagés comme le système de ‘chasse d’eau’ (cf. Le désenvasement du Mont St Michel), ou la remise en suspension occasionnelle mécanique automatisée de la vase ?
Inondations et hydrologie.
Nous savons maintenant que les changements climatiques augmenteront les risques de sécheresse en été et d’inondations en hiver dans les prochaines décennies et il est important d’en tenir compte dès à présent.
Plusieurs problèmes ont pu être constaté lors des inondations de 2018, les vannes étaient bloquées et la bonde inutilisable car bouchée par les sédiments puis au cours de l’hiver 2023-2024. Au niveau le plus haut de la crue du 3 janvier, il est apparu que le système de manipulation de la vanne au niveau du déversoir était immanœuvrable, bloqué par un embâcle, la bonde était et est toujours hors service. Le Projet semble supprimer le déversoir et la vanne actuels. Avec quelles conséquences pratiques sur l’hydrologie aval ? Une échelle de crue existe au niveau de la ‘source ferrugineuse des fées’. Son enregistreur associé est-il toujours fonctionnel ? Nous ne le croyons pas. Comment s’opère actuellement une alerte en cas de crue hors-norme ? Les vues aériennes du réseau hydrographique de la Vée montrent des pratiques agricoles pouvant augmenter les risques d’inondation. En effet, diverses parcelles montrent des sillons de labourage dans le sens de la plus grande pente et non en parallèle aux courbes de niveau. Il est bien connu que cette pratique :
1) augmente la vitesse d’écoulement de l’eau issue des précipitations (neige et pluie),
2) diminue l’eau phréatique disponible,
3) favorise l’érosion des sols
Sécheresses. Y a-t-il eu dans le passé des dispositifs visant à réguler le débit de La Vée, c’est à dire en modérant les crues tout en assurant un écoulement d’eau suffisant en été? Ces dispositifs ont-ils été entretenus et sont-ils fonctionnels à Bagnoles ? Nous en doutons. Ces systèmes ont cependant fait leurs preuves ailleurs, dans le cas de la Marne et du Lac du Der par exemple. Le Projet permet-il de préserver les ressources en eau en été ? A notre avis, ce n’est pas le cas.
Biodiversité.
Le Projet évoque très peu la biodiversité et pas du tout les espèces protégées habitant sur le site. La ville de Bagnoles est située au centre d’une zone naturelle remarquable (Forêt d’Andaine et Parc Naturel Régional de Normandie-Maine) comportant plusieurs ZNIEFFs (Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et Natura 2000. D’après l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), il y a au-moins 101 espèces protégées actuellement répertoriées sur la commune de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie. Environ un tiers de ces espèces dépend peu ou prou du Lac pour son alimentation et son cycle biologique. Le Projet implique la mise à sec du lac pendant plus d’un an et ferait ainsi disparaître totalement l’essentiel de la faune et de la flore aquatique du lac, en particulier la macrofaune et les macrophytes. Certains organismes microscopiques pourraient perdurer grâce à leurs formes de résistance (espèces unicellulaires, bactéries et virus en particulier). Est-ce que Le Projet tient compte de la biodiversité locale et de sa nécessaire protection ; prévoit il des mesures compensatoires ? Cela ne nous semble pas le cas.
L’amélioration de la continuité écologique est mise en avant dans le cadre de ce projet. Cette affirmation nous semble totalement inexacte pour les raisons suivantes :
1) Nous ne voyons pas pourquoi une digue construite avec le but d’isoler une rivière d’un étang constitue une continuité écologique et en particulier hydro-écologique pour les organismes aquatiques alors qu’il s’agit de toute évidence d’un obstacle. Les poissons de la Vée ne sont pas des poissons volants !
2) La digue est totalement artificielle et crée pratiquement deux rives quasi abiotiques et non colonisables par la ripisylve.
3) La notion de trame verte et bleue réellement importante pour ce site parait inconnue ou en tout cas non prise en compte des auteurs du Projet.
4) La passe à ralentisseurs pour les poissons est un sujet important et à part entière. Actuellement nous doutons fortement qu’elle soit fonctionnelle. Le Projet ne détaille pas l’installation prévue pour la remplacer.
Pollutions et nutriments. Au niveau de l’écologie globale, le Projet n’aborde pas d’évaluation bénéfices – risques apportés par Le Lac. Hypothèse : le Lac pourrait fonctionner actuellement comme une sorte de site de lagunage permettant une modeste amélioration de la qualité de l’eau via la photosynthèse de sa végétation. Par exemple, des molécules d’origine agricole comme les nitrates pourraient actuellement être métabolisées par les arbres, la végétation rivulaire et les organismes autotrophes aquatiques. Y a-t-il des analyses comparatives de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de la Vée en amont et en aval du Lac ? Le fait de transformer le lac en étang risque-t-il de favoriser dans ce plan d’eau l’apparition de cyanobactéries toxiques et/ou de blooms d’eutrophisation. C’est un risque important à considérer et à évaluer. Au titre du principe de précaution des analyses du phytoplancton du lac nous sembleraient pour le moins opportunes.
Sciences sociétales
Une consultation a été organisée le 8 octobre 2023 pour recueillir l’avis des bagnolaises et des bagnolais sur Le Projet. Les populations en amont et surtout celles d’aval n’ont pas été consultées alors qu’elles sont concernées par les risques d’inondation, entre autres. Y a-t-il bonne gestion des deniers publics ? Un curage mécanique périodique et polluant est-il meilleur marché qu’un désenvasement naturel et automatique régulier ? Le coût du projet est estimé entre 3 et 4,5 millions d’Euros selon les sources ; son financement n’est pas détaillé : Y aurait-il des subventions et dans ce cas seraient-elles certaines? Un emprunt ? C’est flou, et selon la formule consacrée quand c’est flou…
Conclusions.
Le Projet présente donc des lacunes importantes, en particulier :
– Aucune mention du risque d’augmentation d’impact des crues ne semble étudié ni même mentionné.
– Aucune prise en compte particulière n’est évoquée pour les espèces protégées du site. Aucun suivi environnemental n’est prévu. Aucune compensation écologique.
– Les causes réelles de l’envasement du lac ne sont pas évoquées.
– La consultation faite des populations locales concernées est très partielle puisqu’il n’y a eu aucune prise en compte des populations en amont du lac et surtout de celles en aval, en particulier celles de Couterne où se trouve un site SEVESO.
Bagnoles mérite bien mieux que ce Projet pour les générations futures. En raison des nombreuses insuffisances exposées ci-dessus, il semblerait opportun de modifier considérablement Le Projet ou mieux de faire un nouveau projet alternatif répondant mieux aux remarques et objections évoquées ci- dessus. Si les informations dont nous disposons sont exactes, l’association LABON serait en train de finaliser un tel projet alternatif et collaboratif.
Noter in fine que n’ayant eu connaissance que d’une partie des informations sur Ce Projet, il est possible que certaines de nos allégations soient incomplètes ou même inexactes. Au besoin, nous sommes disponible pour en débattre publiquement avec d’autres experts, arguments scientifiques contre arguments scientifiques et en toute transparence.
Certifié sincère et véritable, fait à Paris le 23 février 2024
Pierre NOËL, dr ès sciences
Chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle Expert en biodiversité aquatique
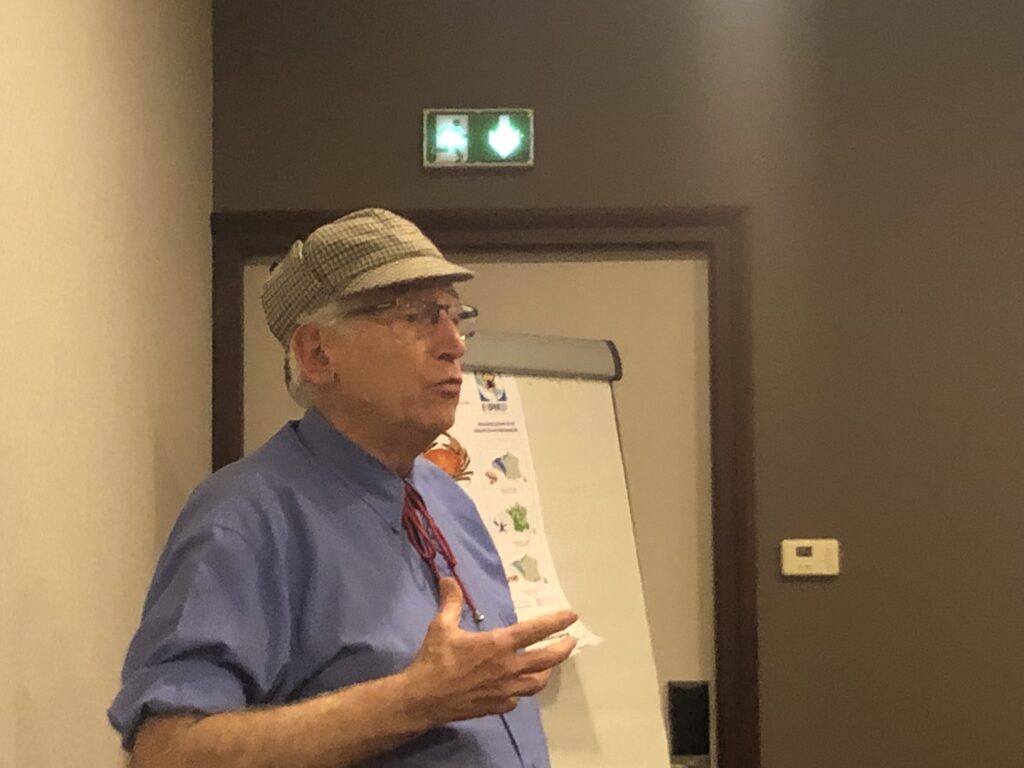
Inventaire des espèces importantes pour le Lac de Bagnoles.
Bonjour … et bienvenue dans le monde des sciences participatives,
Lors de l’Assemblée Générale de l’association LABON le 8 février dernier, le sujet des espèces protégées sur Bagnoles a été évoqué, en particulier pour les espèces aquatiques liées à la Vée et au Lac. Pour augmenter nos informations sur ces espèces, notre conférencier Pierre Noël a accepté que l’on puisse lui envoyer des photos (animaux ou plantes) dans le cadre des sciences participatives locales.
Les photos peuvent lui être envoyées dès maintenant au Muséum à l’adresse courriel suivante : pnoel@mnhn.fr Ne pas oublier de mentionner :
1) le plus exactement possible le lieu et la date de la prise de vue
2) le nom du photographe (pour le copyright ©) [ou un pseudo si vous ne voulez pas que votre nom soit associé à la photo qui sera visible ; cf. le RGPD*]
3) le nom proposé pour l’espèce (facultatif) et des informations complémentaires liées à l’observation (si disponibles).
Exemple de courriel à pnoel@mnhn.fr : Bonjour, veuillez trouver ci joint la photo d’un groupe de canards photographiés le 7 février 2021 sur le Lac de Bagnoles près du casino. La photo est de Léon SEVY. Pour l’espèce, je pense qu’il s’agit du canard colvert. NB. Une cane était suivie de plusieurs canetons, preuve que l’espèce se reproduisait à cet endroit à cette époque de l’année. Bien cordialement. LS.
Une alternative possible plus courte en cas d’envoi de plusieurs photos d’espèces différentes est de nommer la photo à l’aide de ces mêmes informations, ce qui donnerait pour le nom de la photo dans le cas présent : Colverts_CasinoLacBagnoles_5fév2021©LéonSEVY.JPG
V os photos seront utilisées dans le cadre du programme de sciences participatives iNaturalist (https://www.inaturalist.org) principalement pour la validation scientifique. Les informations recueillies seront ensuite intégrées à l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).
Les espèces protégées suivantes déjà signalées de Bagnoles dans l’INPN sont plus particulièrement recherchées car ± inféodées aux milieux aquatiques :
| Aigrettes (grande et petite) Bergeronnette (3 espèces) Brochet Bruant des roseaux Canard colvert Chauves-sourisCigogne blanche Couleuvre à collier Crapauds (3 espèces : commun, épineux et accoucheur) Cygne tuberculé Goélands (2 espèces) | Grand Cormoran Grenouilles (3 espèces) Héron cendré Lamproie de Planer Loutre Martin-pêcheur d’Europe Mouette rieuse Osmonde royale Poule d’eau Rossignol philomèle Salamandre tachetée Triton (3 espèces) |
Les photos anciennes et les photos des autres espèces prises sur la commune de Bagnoles ou à proximité immédiate sont également les bienvenues ; en particulier
– les espèces peu communes ou mal répertoriées à Bagnoles (ex. écureuil, hérisson, escargots et limaces)
– les espèces que vous ne connaissez pas et dont vous aimeriez connaître le nom (ex. petits oiseaux, rapaces, reptiles, amphibiens, orchidées).
Dans la mesure du possible, Pierre Noël vous tiendra informé du devenir de vos observations. Vous pouvez vous adresser directement à lui pour d’éventuelles informations complémentaires.
Merci pour votre aide à la protection des zones naturelles de Bagnoles, Bien cordialement,
Pour l’Association des Amis de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie, le bureau .
* Le RGPD ou règlement général de protection des données est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union européenne (UE). Il est entré en application le 25 mai 2018.
Laisser un commentaire